La Corée coloniale: un nationalisme géopolitique
Published:: 2022-10-03
Author:: William Favre
Topics:: [Korea] [Colonialism - Imperialism ] [Military history]
[1] Kang, Man-gil, Séoul, 1994, pp. XV-XVI.
Introduction
Les relations coréano-japonaises sur le temps long sont d’une richesse particulière en flux autant que matériels qu’immatériels, au cours des siècles que les écrits et autres traces archéologiques ont su conserver. L’histoire moderne des relations entre la Corée et le Japon s’est complexifiée sur plusieurs aspects, notamment politiques et sociaux. L’entrée de ces deux territoires dans la période des impérialismes et plus tard dans le concert des nations ne se fait pas sans conséquences néfastes pour les deux entités, qu’elles passent soit par l’écrasement de certaines minorités (aïnous ou okinawaïens) ou par des relations de dépendances politiques[1].
Nous parlerons ici essentiellement de la Corée plus que du Japon pour ne pas prendre en pertinence mais pour également procéder à un examen un peu plus conscrit d’un épisode long des plus problématiques de l’histoire moderne de la Corée moderne, à savoir de la période coloniale. Ce travail n’a pas la prétention de couvrir de manière exhaustive en si peu de pages l’histoire de la période coloniale coréenne. La problématique est la suivante: quelle est l’impact de la colonisation japonaise dans sa mise en place sur la formation de l’identité nationale de la Corée ?
Le parcours couvre un schéma chronologique allant de 1876 à l919 environ, séquence temporelle où le statut passe par différentes mutations: de royaume à colonie en passant par celui d’empire. Ce travail tire une bonne partie de son ancrage théorique dans les écrits La création des identités nationales, traitant de la même question mais pour le cas européen.
Nous parlerons ici essentiellement de la Corée plus que du Japon pour ne pas prendre en pertinence mais pour également procéder à un examen un peu plus conscrit d’un épisode long des plus problématiques de l’histoire moderne de la Corée moderne, à savoir de la période coloniale. Ce travail n’a pas la prétention de couvrir de manière exhaustive en si peu de pages l’histoire de la période coloniale coréenne. La problématique est la suivante: quelle est l’impact de la colonisation japonaise dans sa mise en place sur la formation de l’identité nationale de la Corée ?
Le parcours couvre un schéma chronologique allant de 1876 à l919 environ, séquence temporelle où le statut passe par différentes mutations: de royaume à colonie en passant par celui d’empire. Ce travail tire une bonne partie de son ancrage théorique dans les écrits La création des identités nationales, traitant de la même question mais pour le cas européen.
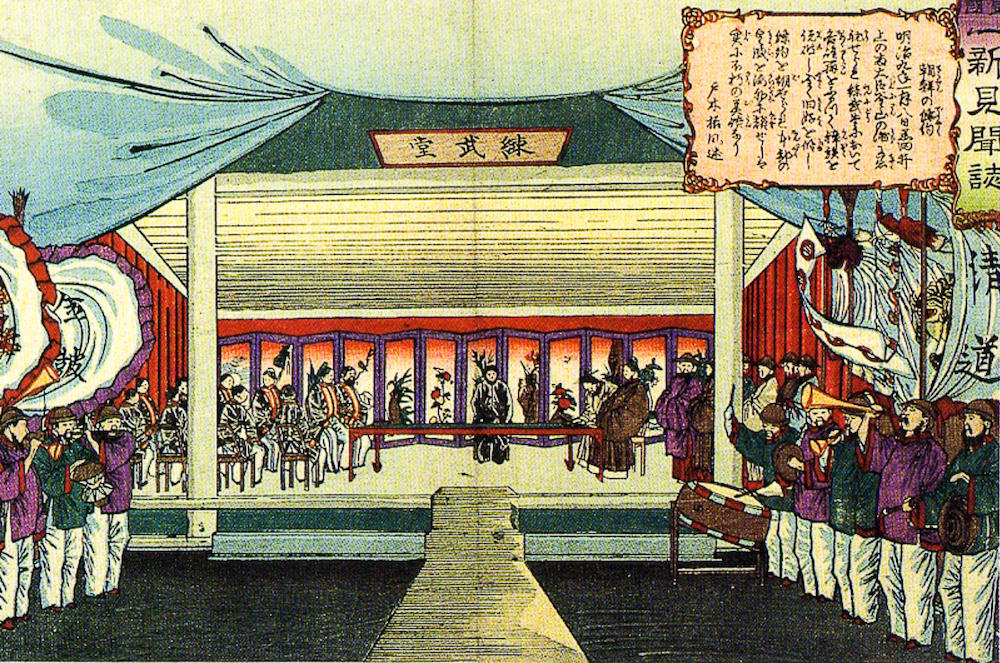
[2] Kang, Man-gil, Séoul, 1994, p. 179.
[3] Kang, Man-gil, Séoul, 1994, pp. 4-5.
[4] Terme japonais pour les « femmes de réconfort », wianbu en coréen.
[5] Lévy, Christine, Online Encyclopedia of Mass Violence, 2012, p. 4.
[6] Lévy, Christine, Online Encyclopedia of Mass Violence, 2012, p. 5.
[7] Kang, Man-gil, Séoul, 1994, p. 131.
[8] Nanta, Arnaud, Matériaux pour l’histoire de notre temps, 2005, p. 16.
La formation de l’identité nationale coréenne sous l’occupation japonaise
L’un des principaux paradoxe du nationalisme coréen mais également de la Corée à ce jour dans son état géographique actuel est son incomplétion[2]. Le projet du nationalisme coréen qui est de réunir les deux Corées, celle du nord et celle du sud en une seule entité territoriale sous une seule bannière semble être compromis depuis 1953. A mesure que le temps passe, le sentiment d’une Corée unie, mais aussi d’une Corée monolithique dans son identité culturelle semble se racornir avec la création d’identités propres à chaque Corée. La question de la probabilité de la réalisation du projet de la réunification n’est pas ici pertinent mais il s’agit principalement de se demander comment les deux Corées, principalement la Corée du Sud, utilise cet épisode pour alimenter son discours national[3]. La Corée du Sud est la principale concernée car ce sont principalement les sources sud-coréennes auquel nous avons le meilleur accès. La Corée du Nord reste un régime politique où l’accès aux archives est strictement contrôlé par l’état et où le nombre d’archive accessible est inconnu. La posture de la Corée du Sud, plus précisément du gouvernement qui est à différencier de celle de la population fluctue selon les situations et le pouls de la vie diplomatique entre les deux pays. La posture sud-coréenne dans sa globalité reste surtout depuis la fin des années 1980 constant, celle de la nécessité du Japon de réparer le coût humain causé par le régime militariste a causé pendant toute la période de 1910 à 1945. Les deux pays entretiennent malgré tout de bonnes relations économiques malgré ce paysage politique et diplomatique ombrageux et parsemés de scandales dans l’histoire récente.
La fin des années 80 et le début des années 1990 marquent un virage dans le discours de l’état coréen du Sud pour plusieurs raisons: la première est la démocratisation du pays à cette période qui permet une libération de certaines voix, celle de Kim Hak Sun, dû lourd tabou pesant sur les ianfu[4] et la seconde est la manifestation, puis la médiatisation durant cette période de voix dénonçant le système dit des « femmes de réconforts », considéré aujourd’hui comme un crime de guerre du Japon avec le sac de Nankin et l’unité 731[5]. Les années 1980 et 90 sont une période où globalement la Seconde Guerre mondiale occupe le centre du débat public. Citons en exemple l’affaire des fonds en déshérence en Suisse, tandis que la Chine se concentre sur le sac de Nankin. L’épisode des femmes de réconfort joue le rôle, en quelque sorte, d’une impulsion qui fit remonter à la surface des souvenirs mais aussi des griefs qui font débat dans toute l’aire asiatique orientale[6]. Le souvenir des femmes de réconfort en cristallise un autre, celui largement néfaste que les Coréens gardent de la période coloniale japonaise. Parmi les autres éléments douleureux, nous pouvons retenir les soldats coréens enrôlés de force dans les armées japonaises ou les travailleurs forcés emmenés pour palier au manque de main-d’oeuvre dans les usines japonaises durant la Guerre de quinze ans[7]. Le traumatisme de la Guerre de Corée est également toujours présent, ressenti comme un tournant majeur, tragique. Telle une déchirure, caractéristique d’une guerre civile, les membres d’un même corps social s’affrontent suivant une méthode de guerre totale. Dans la mémoire collective, les deux épisodes sont séparés même si les deux évènements restent liés par une relation de causalité direct. Il est intéressant, voire intriguant de constater que l’historiographie coréenne principalement en mémoire de l’épisode colonial japonais qu’une portion qui correspond aux dernières années de la colonisation, allant de 1941 à 1945. Il est indéniable que les dernières années concentrent les plus douloureuses expériences de la colonisation mais tend à homogénéiser ce qui précède, à savoir toute la période allant au plus tard de 1910 à 1941[8]. Comment expliquer cette tendance ? Il existe plusieurs arguments qui puissent éclairer cette zone d’ombre. Il pourrait s’agir d’un biais psychologique, sociologique qui tend à ne fixer que dans la longue durée que les événements les plus négatifs dans les esprits. Il se pourrait que cela soit causé sciemment par le gouvernement sud-coréen dont l’une des stratégies discursives serait de souder ses citoyens autour de questions avec le plus grand potentiel de mobilisation possible. La Guerre du Pacifique est son suspect idéal canalise le débat national sur une préoccupation unique. La réponse la plus raisonnable est probablement située entre ces deux pôles, l’un nourrissant l’autre dans son propos.
La fin des années 80 et le début des années 1990 marquent un virage dans le discours de l’état coréen du Sud pour plusieurs raisons: la première est la démocratisation du pays à cette période qui permet une libération de certaines voix, celle de Kim Hak Sun, dû lourd tabou pesant sur les ianfu[4] et la seconde est la manifestation, puis la médiatisation durant cette période de voix dénonçant le système dit des « femmes de réconforts », considéré aujourd’hui comme un crime de guerre du Japon avec le sac de Nankin et l’unité 731[5]. Les années 1980 et 90 sont une période où globalement la Seconde Guerre mondiale occupe le centre du débat public. Citons en exemple l’affaire des fonds en déshérence en Suisse, tandis que la Chine se concentre sur le sac de Nankin. L’épisode des femmes de réconfort joue le rôle, en quelque sorte, d’une impulsion qui fit remonter à la surface des souvenirs mais aussi des griefs qui font débat dans toute l’aire asiatique orientale[6]. Le souvenir des femmes de réconfort en cristallise un autre, celui largement néfaste que les Coréens gardent de la période coloniale japonaise. Parmi les autres éléments douleureux, nous pouvons retenir les soldats coréens enrôlés de force dans les armées japonaises ou les travailleurs forcés emmenés pour palier au manque de main-d’oeuvre dans les usines japonaises durant la Guerre de quinze ans[7]. Le traumatisme de la Guerre de Corée est également toujours présent, ressenti comme un tournant majeur, tragique. Telle une déchirure, caractéristique d’une guerre civile, les membres d’un même corps social s’affrontent suivant une méthode de guerre totale. Dans la mémoire collective, les deux épisodes sont séparés même si les deux évènements restent liés par une relation de causalité direct. Il est intéressant, voire intriguant de constater que l’historiographie coréenne principalement en mémoire de l’épisode colonial japonais qu’une portion qui correspond aux dernières années de la colonisation, allant de 1941 à 1945. Il est indéniable que les dernières années concentrent les plus douloureuses expériences de la colonisation mais tend à homogénéiser ce qui précède, à savoir toute la période allant au plus tard de 1910 à 1941[8]. Comment expliquer cette tendance ? Il existe plusieurs arguments qui puissent éclairer cette zone d’ombre. Il pourrait s’agir d’un biais psychologique, sociologique qui tend à ne fixer que dans la longue durée que les événements les plus négatifs dans les esprits. Il se pourrait que cela soit causé sciemment par le gouvernement sud-coréen dont l’une des stratégies discursives serait de souder ses citoyens autour de questions avec le plus grand potentiel de mobilisation possible. La Guerre du Pacifique est son suspect idéal canalise le débat national sur une préoccupation unique. La réponse la plus raisonnable est probablement située entre ces deux pôles, l’un nourrissant l’autre dans son propos.
[9] Delissen, Alain, Ecrire l’histoire, 2009, p. 2.
[10] Delissen, Alain, idem, p. 2.
[11] Shin, Gi-Wook, Seattle et Londres, 1996, p. 4.
[12] Shin, Gi-Wook, idem, p. 4.
[13] Iwao Seiichi, Sakamato Tarō, Hōgetsu Keigo, Yoshikawa Itsuji, Kobayashi Tadashi, Kanazawa Shizue. 210. Corée. In: Dictionnaire historique du Japon, volume 3, 1975. Lettre C. pp. 146-151, p. 150.
Qu’en est-il du reste de la période, quels en peuvent être les points d’accroche pour le discours nationaliste ? Du moins que sont les éléments sur lesquels se rattachent les partisans d’un tel discours ? Il existe plusieurs portes d’entrée dont la plupart ont trait avec l’histoire politique de la région de l’Asie orientale. L’histoire coloniale de la Corée reste surtout celui d’un sentiment de petitesse ou d’impuissance par rapport aux aléas du concert des nations, mais aussi des ambitions de puissances occidentales ou de ses voisins[9]. Cette sensation se retrouve même dans les interprétations que retirent les géographes de la forme tracée par les frontières de la Corée. Les uns y voit un tigre, notamment les Coréens voulant y voir un signe modernisateur, alors que Kotô Bunjirô y voit un animal autrement plus docile, un lapin[10]. Ce sentiment remonte à la fin du XIXe siècle, lorsque des puissances occidentales comme la France ou les Etats-Unis voient la Corée comme une étape de choix pour le ravitaillement des baleiniers dans leur remontée depuis le Pacifique sud vers le nord, où se trouve la majorité des stocks de baleine. Le royaume se montre hostile à l’infiltration de ces puissances en connaissance de ce qui advint de la Chine des Qing à l’issue des Guerres de l’opium, peu à peu grignotée par les puissances occidentales tandis que le gouvernement central se délitait petit à petit. La Corée, alors considérée par les Occidentaux comme un « royaume-ermite » craint et réprime tous les éléments à l’intérieur du royaume qui puissent encourager une ouverture de ses frontières. La royauté, notamment dirigée par le père du futur roi Kojong, le régent Daewongun souhaite ne pas perdre l’assise royale, alors minée par les insurrections paysannes et l’emprise des familles de yangban dont la tendance à ne pas payer d’impôts entame les caisses du royaume et sa capacité à entreprendre ses projets de redressement du pays[11]. A l’instar du Japon, le pays du matin calme est traversé par plusieurs courants conservateurs qui rejettent l’influence des étrangers, mais aussi d’autres se demandant s’il ne serait pas nécessaire de réformer le pays afin de ne pas souffrir d’un retard technologique et militaire par rapport aux canonnières occidentales[12]. Le Japon devient un exemple à suivre pour les tenants de ce mouvement, dont l’un des mouvances se nomme le sirhak ou les études de l’ouest en référence à Pékin, par où transitaient les connaissances de/sur l’Occident avant de pénétrer en territoire coréen. La prise de Pékin en 1861 et l’ouverture du Japon provoque un vent de panique et une volonté de retour d’un régime plus proche des fondamentaux confucianiste. Le modèle chinois, au lendemain de la défaite de 1895, subit une déchéance dans l’estime de la génération de yangban au tournant du XXe. Dès les premières années de la présence étrangère, l’Occident ou ses représentants sont perçus de manière ambivalente par les Coréens, mais en grande partie uniquement des élites dont on possède le plus de traces écrites. Les Occidentaux ( déjà à partir des années 1850 ) sont observés comme de potentiels dangers pour la souveraineté politique de la péninsule et se confirme dans les années qui suivent. Un avis minoritaire voit en ces derniers une occasion de pouvoir faire évoluer la Corée ou comme un nouvel horizon symbolique[13]. Ce potentiel d’amélioration, surtout militaire, que présentent les puissances coloniales serait principalement un outil pour mieux résister à la présence étrangère aux yeux des élites intermédiaires des milieux urbains, comme Séoul ou Busan.
[14] Kang, Man-gil, Séoul, 1994, p. 100.
[15] Kang, Man-gil, idem, p. 100.
[16] Dayez-Burgeon, Pascal, Paris, 2012, p. 110
[17] Iwao Seiichi, Iyanaga Teizō, Ishii Susumu, Yoshida Shōichirō, Fujimura Jun'ichirō, Fujimura Michio, Yoshikawa Itsuji, Akiyama Terukazu, Iyanaga Shōkichi, Matsubara Hideichi. 20. Saigō Takamori (1828-1877). In: Dictionnaire historique du Japon, volume 17, 1991. Lettres R (2) et S (1) pp. 73-74.
[18] Dayez-Burgeon, Pascal, Paris, 2012, p. 113
[19] Iwao Seiichi, Iyanaga Teizō, Ishii Susumu, Yoshida Shōichirō, Fujimura Jun'ichirō, Fujimura Michio, Yoshikawa Itsuji, Akiyama Terukazu, Iyanaga Shōkichi, Matsubara Hideichi. 20. Saigō Takamori (1828-1877). In: Dictionnaire historique du Japon, volume 17, 1991. Lettres R (2) et S (1) pp. 73-74.
A ce stade, le nationalisme coréen n’est pas présent et se trouve être à un stade embryonnaire. Il se manifeste comme un sentiment diffus au sein de larges portions de la population de l’existence d’un distingo. Il existe une conscience d’une différence entre les Coréens et les étrangers, qui devient « le diable blanc ». Il semble encore trop pour parler véritablement de l’émergence d’un sentiment xénophobe ciblé avant 1876, date à laquelle s’ouvre le premier complexe portuaire coréen intégré au système des concessions internationales, le fort de Ganghwa et le port de Chemulpo, de son nom moderne Incheon, aux portes de Séoul. La date de 1876 marque l’aboutissement d’un phénomène qui a déjà cours depuis la fin des années 1860 mais qui est appelé à s’accroître dans les décennies qui suivent, à savoir la présence japonaise, au départ officieuse. L’irruption de ressortissants japonais dans le paysage coréen, plus précisément dans les ports se fait à la faveur de l’ouverture du Japon dès 1854 avec la signature du premier traité inégal japonais. Les deux principaux par ouvert sont ceux de Shimoda et de Hakodate. Suit peu après l’établissement des concessions occidentales dans les ports de Yokohama et de Kobe. Ces premiers ports ouverts servent de zones d’embarquements pour des ressortissants de conditions sociales différentes en direction du continent. Il faut toutefois attendre la stabilisation de la situation politique du Japon à partir de 1868 pour apercevoir les premiers contingents importants de Japonais sur le continent, notamment en Corée et la façade maritime chinoise. Les contacts commerciaux entre le Japon et la Corée vont considérablement augmenté pour le reste du siècle qui profite essentiellement au Japon. Ce sont essentiellement des aventuriers, issus de populations déclassées par les bouleversements sociaux de la fin du shogunat, qui foulent le sol de la péninsule à la recherche d’un produit particulier: le riz[14]. La Corée fut considérée dès le début de la présence japonaise comme un territoire agricole, un grenier à riz à même de fournir le Japon en cas de pénurie, ainsi que pour d’autres ressources tels que le charbon ou le fer[15]. Ces aventuriers ou marchands peu scrupuleux cherchent majoritairement à faire des coups commerciaux ou des entourloupes en essayant d’acheter le riz coréen au meilleur prix possible[16].
La seule présence des marchands aux pratiques douteuses et les milieux proches n’expliquent pas totalement une hostilité accrue dans l’attitude coréenne envers le Japon et vice-versas. Le Japon exerce une pression politique de plus en plus grande sur la Corée, surtout à l’issue de plusieurs ambassades diplomatiques rejetées par les Coréens mais aussi par l’incident de Ganghwa en 1876. Cela encourage notamment les clans des anciens fiefs de Chôshû et de Satsuma à faire pression sur le Parlement japonais pour une expédition punitive sur le continent. Parmi les partisans les plus ardents de cette doctrine de régler par la force les rapports diplomatiques est Saigô Takamori, un bushi de la province de Satsuma. L’aile dure du parti interventionniste n’a pas le vent en poupe et Saigô se retire du gouvernement impérial, qui considère une intervention militaire trop précoce[17]. Le Japon décide plutôt de ne pas opter pour l’intervention militaire mais plutôt pour un blocus sur le pays avant que celui-ci n’accepte de signer un traité inégal conférant l’extraterritorialité aux Japonais[18]. Ce premier pas marque une mutation dans les relations internationales en Asie de l’Est car nous observons avec le Japon l’appropriation par un pays non-occidental du même langage diplomatique par lequel il a été intégré de force au système des relations internationales[19]. L’adoption par le Japon d’un programme impérialiste inaugure une nouvelle période dans ces mêmes relations internationales, où la présence japonaise en Corée ne fera qu’augmenter jusqu’à une annexion pure et simple.
La seule présence des marchands aux pratiques douteuses et les milieux proches n’expliquent pas totalement une hostilité accrue dans l’attitude coréenne envers le Japon et vice-versas. Le Japon exerce une pression politique de plus en plus grande sur la Corée, surtout à l’issue de plusieurs ambassades diplomatiques rejetées par les Coréens mais aussi par l’incident de Ganghwa en 1876. Cela encourage notamment les clans des anciens fiefs de Chôshû et de Satsuma à faire pression sur le Parlement japonais pour une expédition punitive sur le continent. Parmi les partisans les plus ardents de cette doctrine de régler par la force les rapports diplomatiques est Saigô Takamori, un bushi de la province de Satsuma. L’aile dure du parti interventionniste n’a pas le vent en poupe et Saigô se retire du gouvernement impérial, qui considère une intervention militaire trop précoce[17]. Le Japon décide plutôt de ne pas opter pour l’intervention militaire mais plutôt pour un blocus sur le pays avant que celui-ci n’accepte de signer un traité inégal conférant l’extraterritorialité aux Japonais[18]. Ce premier pas marque une mutation dans les relations internationales en Asie de l’Est car nous observons avec le Japon l’appropriation par un pays non-occidental du même langage diplomatique par lequel il a été intégré de force au système des relations internationales[19]. L’adoption par le Japon d’un programme impérialiste inaugure une nouvelle période dans ces mêmes relations internationales, où la présence japonaise en Corée ne fera qu’augmenter jusqu’à une annexion pure et simple.
[20] Delissen, Alain, Ecrire l’histoire, 2009, p. 158.
[21] Shin, Gi-Wook, Seattle, 1996, p. 38.
[22] Dayez-Burgeon, Pascal, Paris, 2012, p. 120.
[23] Dayez-Burgeon, Pascal, Paris, 2012, pp. 36-37.
[24] Dayez-Burgeon, Pascal, Paris, 2012, pp. 38.
[25] Iwao Seiichi, Iyanaga Teizō, Ishii Susumu, Yoshida Shōichirō, Fujimura Jun'ichirō, Fujimura Michio, Yoshikawa Itsuji, Akiyama Terukazu, Iyanaga Shōkichi, Matsubara Hideichi. 8. Portsmouth jōyaku. In: Dictionnaire historique du Japon, volume 16, 1990. Lettres N (2), O, P et R (1) pp. 158-159.
L’adoption par les Japonais, suivi de près par les Chinois avec l’installation d’une garnison en pleine capitale royale de Séoul à l’issue du traité de Haesong indique l’entrée définitive quoique modeste des pays de l’Asie orientale dans le jeu des Grandes Puissances. Les pays ayant nouvellement adopté le langage des impérialismes jouent des coudes pour s’imposer en Corée, cette « Italie de l’Extrême-Orient »[20], dans le but d’obtenir les meilleures concessions de la royauté coréenne, tributaire des agissements d’acteurs divers. Les principaux intervenants du théâtre coréen sont les Russes, les Américains et les Japonais. Les Anglais, quant à eux, semblent rester en retrait de cette zone et se reposent sur les Japonais à défaut d’une présence propre. La Corée devient dès les années 1880 jusqu’au tournant du siècle un terrain du Grand Jeu des puissances, tels un territoire à la frontière de plusieurs empire n’appartenant encore formellement à personne. Cette situation mène à une accumulation des tensions entre les différents empires, ce qui aboutit à l’éclatement de conflits majeurs dans la région de la Mandchourie et de Corée, réduits à l’état de champ de bataille. Deux guerres majeures secouent la région, avec pour trait commun le Japon pour principal belligérant: la Première Guerre sino-japonaise, mais aussi la Guerre russo-japonaise, respectivement en 1894-5 et en 1904-5. Les deux conflits mettent successivement hors de la compétition pour l’hégémonie de la Corée les deux principaux concurrents du Japon que sont la Chine et l’Empire russe pendant la période du Grand Jeu. Les révoltes paysannes du donghak de 1894, évènements déclencheurs de la Guerre sino-japonaise conduisent la royauté coréenne à s’appuyer sur des armées étrangères pour mâter ses propres troubles internes[21]. Sauf que les troupes qu’elle appela à l’aide se sont elles-même battues par le Japon. La défaite entérine le fait que la Chine ne remplit plus correctement le rôle de modèle civilisationnel pour la Corée[22]. Le royaume se tourne alors vers le vainqueur et ses voisins les plus proches, le Japon et la Russie impérialistes, dont la formule impériale inspira probablement le roi Kojong. Le monarque proclama d’ailleurs en 1897 la fondation de l’Empire de Corée, comme un premier pas vers l’affirmation du pays comme un territoire souverain dans le concert des nations. Cet empire plus de forme que de fait ne survit que peu de temps face aux maladresses politiques du roi Kojong, dont l’une des décisions est de se réfugier dans l’ambassade russe après l’assassinat de la reine Min en 1895, mécontente les Japonais. Les réformes de Kabo en 1896 améliorent sensiblement la situation interne du pays et le modernisent institutionnellement, mais le monarque reste autocratique dans sa vision de l’exercice du pouvoir. La population déprécie de plus ou plus la royauté en général, comprenant que le roi est impuissant face au Japon. Un fait capital et qui reste un évènement majeur dans la formation de l’identité nationale du pays est la résurgence du mythe de Dangun, premier souverain mythique de la Corée[23]. Ce mythe compilé au XIIIe siècle est remis au goût du jour pour donner un mythe fondateur et un grand ancêtre à l’ensemble de la Corée. Ainsi, la tonalité culturelle de son identité est ancrée dans le monde sibérien, entre chamanisme et ours. Le territoire ainsi délimité, sanctifié par le mythe a pour épicentre le mont Paektu, clé de voûte d’une carte, d’un tracé national que l’on tente d’affermir depuis la dynastie Choson. Le mythe de Dangun reprend une place de choix dès la fondation en 1909 du daejonggyo, association à double composante religieuse et nationaliste considère Dangun une figure tutélaire[24]. La figure du Dangun ne semble être utilisée seulement après la destitution de Kojong par les Japonais en 1907, cela atteste d’un développement annexe à la royauté qui préférait se reposer sur un modèle confucianiste chinois.
Comme troisième acteur, les Etats-Unis se concentrent leurs efforts sur d’autres territoires durant la même période tout en adoptant un comportement tout autant impérialiste, notamment en Amérique centrale et en Asie du sud-est. Pour les Etats-Unis, cela culmine par leur victoire sur l’Empire espagnol en 1898, qui perd le contrôle de ses dernières colonies de Cuba et des Philippines. Le Japon devient à l’issue du traité de Portsmouth en 1905 le pays avec lequel compter dans la région et en profite pour incorporer la péninsule dans son empire colonial en tant que première zone tampon entre l’archipel principal et l’Empire russe[25].
Comme troisième acteur, les Etats-Unis se concentrent leurs efforts sur d’autres territoires durant la même période tout en adoptant un comportement tout autant impérialiste, notamment en Amérique centrale et en Asie du sud-est. Pour les Etats-Unis, cela culmine par leur victoire sur l’Empire espagnol en 1898, qui perd le contrôle de ses dernières colonies de Cuba et des Philippines. Le Japon devient à l’issue du traité de Portsmouth en 1905 le pays avec lequel compter dans la région et en profite pour incorporer la péninsule dans son empire colonial en tant que première zone tampon entre l’archipel principal et l’Empire russe[25].
[26] Shin, Gi-Wook, Seattle et Londres, 1996, p. 37.
[27] Iwao Seiichi, Iyanaga Teizō, Yoshida Shōichirō, Ishii Susumu, Fujimura Jun'ichirō, Fujimura Michio, Yoshikawa Itsuji, Akiyama Terukazu, Iyanaga Shōkichi, Matsubara Hideichi. 199. Itō Hirobumi (1841-1909). In: Dictionnaire historique du Japon, volume 9, 1983. Lettre I. p. 101.
[28] Kang, Man-gil, Séoul, 1994, pp. 5-6
[29] Kang, Man-gil, Séoul, 1994, pp. 162-163.
[30] Kang, Man-gil, Séoul, 1994, pp. 165-167.
[31] Dayez-Burgeon, Pascal, Paris, 2012, pp. 129-130.
[32] Dayez-Burgeon, Pascal, ibid., pp. 128-129.
[33] Dayez-Burgeon, Pascal, ibid., p. 128.
[34] Kang, Man-gil, Séoul, 1994, pp. 98-100.
[35] Kang, Man-gil, ibid., pp. 146-147.
Comment la Corée réagit-elle à une telle situation ? Quels effets cela a-t-il sur la construction de la Corée en état-nation ? Nous avons évoqué la tentative tardive de muer le royaume en une forme plus apte à relever les défis du temps, du moins idéalement. Or le fait de transformer le royaume en empire enterre le modèle sino-centrique pour de bon mais sans bouleverser le rapport de forces entretenus avec les Occidentaux et les Japonais. La présence de plus en plus oppressante du Japon, parallèlement à un affaiblissement de la monarchie aboutit à une confluence de la frustration paysanne sur une xénophobie envers les Japonais et des administrateurs royaux véreux, tous deux responsables des mauvaises conditions de vie des classes les plus prolétarisées de la population, pour la plupart journaliers[26]. On assiste donc à une double dynamique, théorisée par Eric Hobsbawm, top to bottom et bottom to top où la population s’exprime sur le sujet tels que la trajectoire prise par le pays. La population s’organise en mouvements de résistance face à l’annexion de leur pays par leur voisin lorsqu’un groupe de résistance en particulier décide d’assassiner en 1909 le résident général de Corée, Itô Hirobumi[27] en représailles à l’assassinat de la reine Min, près de 14 ans plus tard. Une telle tentative de se défaire du numéro un du régime japonais en Corée n’est pas sans conséquence. Il accélère la prise brutale de la Corée par le Japon en 1910[28]. Cet homicide peut être analysé comme faisant partie d’une stratégie visant à affaiblir l’occupant et de créer un exemple de résistance pour la population, avec comme pour but final l’indépendance coréenne. Les forces à l’oeuvre pour la construction d’une identité nationale coréenne gagne en cohérence et en clarté à cette époque. Les résistances, orientés à l’origine contre les étrangers sans distinguer véritablement l’origine, se focalisent de plus en plus sur le Japon, qui devient une entité-repoussoir à mesure que l’Empire colonial se construit[29].
La période qui suit de 1909 à 1919 ne permet guère de retracer la trajectoire de la construction nationale coréenne déjà bien entamée en une période de temps relativement courte. L’interdit japonais de produire des écrits en coréen mais également la fermeture des écoles entraîne une baisse du total des sources exploitables par les historiens. Ceux-ci doivent dès lors se fonder en grande partie sur les sources japonaises, plus fournies mais sujettes à caution car biaisées. Or une étape de importante du processus est franchie durant cette période, notamment au niveau linguistique. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le coréen reste une langue orale en majeure partie et l’écrasante majorité des documents administratifs sont historiquement écrits en chinois, langue administrative et culturelle des différents royaumes se succédant en Corée. Le linguiste Ju Si-gyeong invente le terme de hangeul en 1912 pour désigner un système d’écriture jusque-là pratiquement pas utilisé depuis le XVIe. Remise au goût du jour, il ambitionne d’en faire le support écrit de la langue coréenne. [30]Ju Si-gyeong est l’acteur-clé parmi d’autres du processus de la standardisation grammaticale et syntaxique de la langue coréenne, dont les règles ne sont pas codifiées formellement jusqu’au moment de son intervention. La presse indépendantiste coréenne, notamment le journal the Journal of Independance de Seo Jae-pil est un puissant outil quant à la diffusion et l’usage de plus en plus étendu de la langue écrite coréenne. Ce journal au nom et à la rédaction bilingues, grâce au potentiel de large diffusion de la presse moderne, permet à la population coréenne de s’intéresser à la question de l’indépendance mais aussi de se familiariser avec ce système d’écriture nouvellement recréé pour un usage contemporain[31]. Ce quotidien est le fer de lance culturelle du Club de l’indépendance, organisation indépendantiste résolument moderniste qui cherche à trouver une troisième voie différente des trajectoires historiques du Japon et de la Chine[32]. Le fait même d’avoir son propre système d’écriture affirme une volonté de ses concepteurs de se distancier d’anciens modèles culturels, par exemple du modèle chinois pour les systèmes d’écriture. L’intention de trouver une voie différente, oblige la génération de yangban de Seo Jae-pil de s’adonner à un jeu de funambule quant au modèle à suivre et à questionner la notion de « progrès », entre une option « occidentaliste » ou une option « traditionaliste »[33]. Le Japon perd de plus en plus de crédibilité en tant que voie exemplaire par sa mainmise de plus en plus pesante sur la Corée.
Sur un plan plus social, la présence japonaise sur le sol coréen entraînement des changements sociaux profonds durant la période de 1910 à 1919, qui correspondrait à une période de finalisation de la mise en place de la colonie. C’est un processus qui débute comme on l’a vu bien plus tôt déjà dès les années 1860 par l’arrivée d’aventuriers tentant d’ouvrir des commerces en Corée. Le Japon voit avant tout la Corée d’abord comme le grenier à riz de l’Empire, par la suite comme le premier rempart de l’archipel contre une invasion venant de l’ouest, notamment de son voisin russe, puis soviétique. Les Japonais considèrent par la suite la colonie comme un réservoir de main-d’oeuvres mais aussi d’autres ressources[34], notamment minière au nord de la péninsule mais également comme un territoire à moderniser parce que ce dernier fait la liaison entre l’archipel et le chemin de fer de Mandchourie que le pays acquiert à l’issue de la Guerre russo-japonaise[35]. Les principales mesures de l’administration coloniale sont donc de moderniser les infrastructures routières, ferroviaires et administratives du pays au travers d’investissements conséquents. A l’heure actuelle, cela remet partiellement en cause le rôle du Japon. Il n’est plus essentialisé à un rôle unique de puissance coloniale puisant dans les ressources du pays mais devient un contributeur majeur de la modernisation de la Corée même si cela est pour son intérêt propre. Il est clair que les fruits du progrès technologique et économique de l’époque coloniale fut au bénéfice du Japon et d’une élite économique locale.
La période qui suit de 1909 à 1919 ne permet guère de retracer la trajectoire de la construction nationale coréenne déjà bien entamée en une période de temps relativement courte. L’interdit japonais de produire des écrits en coréen mais également la fermeture des écoles entraîne une baisse du total des sources exploitables par les historiens. Ceux-ci doivent dès lors se fonder en grande partie sur les sources japonaises, plus fournies mais sujettes à caution car biaisées. Or une étape de importante du processus est franchie durant cette période, notamment au niveau linguistique. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le coréen reste une langue orale en majeure partie et l’écrasante majorité des documents administratifs sont historiquement écrits en chinois, langue administrative et culturelle des différents royaumes se succédant en Corée. Le linguiste Ju Si-gyeong invente le terme de hangeul en 1912 pour désigner un système d’écriture jusque-là pratiquement pas utilisé depuis le XVIe. Remise au goût du jour, il ambitionne d’en faire le support écrit de la langue coréenne. [30]Ju Si-gyeong est l’acteur-clé parmi d’autres du processus de la standardisation grammaticale et syntaxique de la langue coréenne, dont les règles ne sont pas codifiées formellement jusqu’au moment de son intervention. La presse indépendantiste coréenne, notamment le journal the Journal of Independance de Seo Jae-pil est un puissant outil quant à la diffusion et l’usage de plus en plus étendu de la langue écrite coréenne. Ce journal au nom et à la rédaction bilingues, grâce au potentiel de large diffusion de la presse moderne, permet à la population coréenne de s’intéresser à la question de l’indépendance mais aussi de se familiariser avec ce système d’écriture nouvellement recréé pour un usage contemporain[31]. Ce quotidien est le fer de lance culturelle du Club de l’indépendance, organisation indépendantiste résolument moderniste qui cherche à trouver une troisième voie différente des trajectoires historiques du Japon et de la Chine[32]. Le fait même d’avoir son propre système d’écriture affirme une volonté de ses concepteurs de se distancier d’anciens modèles culturels, par exemple du modèle chinois pour les systèmes d’écriture. L’intention de trouver une voie différente, oblige la génération de yangban de Seo Jae-pil de s’adonner à un jeu de funambule quant au modèle à suivre et à questionner la notion de « progrès », entre une option « occidentaliste » ou une option « traditionaliste »[33]. Le Japon perd de plus en plus de crédibilité en tant que voie exemplaire par sa mainmise de plus en plus pesante sur la Corée.
Sur un plan plus social, la présence japonaise sur le sol coréen entraînement des changements sociaux profonds durant la période de 1910 à 1919, qui correspondrait à une période de finalisation de la mise en place de la colonie. C’est un processus qui débute comme on l’a vu bien plus tôt déjà dès les années 1860 par l’arrivée d’aventuriers tentant d’ouvrir des commerces en Corée. Le Japon voit avant tout la Corée d’abord comme le grenier à riz de l’Empire, par la suite comme le premier rempart de l’archipel contre une invasion venant de l’ouest, notamment de son voisin russe, puis soviétique. Les Japonais considèrent par la suite la colonie comme un réservoir de main-d’oeuvres mais aussi d’autres ressources[34], notamment minière au nord de la péninsule mais également comme un territoire à moderniser parce que ce dernier fait la liaison entre l’archipel et le chemin de fer de Mandchourie que le pays acquiert à l’issue de la Guerre russo-japonaise[35]. Les principales mesures de l’administration coloniale sont donc de moderniser les infrastructures routières, ferroviaires et administratives du pays au travers d’investissements conséquents. A l’heure actuelle, cela remet partiellement en cause le rôle du Japon. Il n’est plus essentialisé à un rôle unique de puissance coloniale puisant dans les ressources du pays mais devient un contributeur majeur de la modernisation de la Corée même si cela est pour son intérêt propre. Il est clair que les fruits du progrès technologique et économique de l’époque coloniale fut au bénéfice du Japon et d’une élite économique locale.
[36] Kang, Man-gil, Séoul, 1994, p. 146.
[37] Shin, Gi-Wook, Seattle et Londres, 1996, pp. 40-42.
[38] Kang, Man-gil, Séoul, 1994, pp. 158-161.
[39] Shin, Gi-Wook, Seattle et Londres, 1996, pp. 52-53.
[40] Shin, Gi-Wook, ibid. , pp. 52-53.
[41] Kang, Man-gil, Séoul, 1994, pp. 158-159.
[42] Kang, Man-gil, Séoul, 1994, pp. 149-150.
[43] Dayez-Burgeon, Pascal, Paris, 2012, pp. 157-159.
[44] Kang, Man-gil, Séoul, 1994, pp. 26-27.
[45] Iwao Seiichi, Iyanaga Teizō, Ishii Susumu, Yoshida Shōichirō, Fujimura Jun'ichirō, Fujimura Michio, Yoshikawa Itsuji, Akiyama Terukazu, Iyanaga Shōkichi, Matsubara Hideichi. 48. Saitō Makoto (1858-1936). In: Dictionnaire historique du Japon, volume 17, 1991. Lettres R (2) et S (1) pp. 85-86.
[46] Dayez-Burgeon, Pascal, Paris, 2012, pp. 142-143.
[47] Kang, Man-gil, Séoul, 1994, pp. 29-30.
[48] Iwao Seiichi, Iyanaga Teizō, Ishii Susumu, Yoshida Shōichirō, Fujimura Jun'ichirō, Fujimura Michio, Yoshikawa Itsuji, Akiyama Terukazu, Iyanaga Shōkichi, Matsubara Hideichi. 530. Shōwa kyōkō. In: Dictionnaire historique du Japon, volume 18, 1992. Lettre S (2) pp. 104-105.
La Corée bénéficie, avec l’investissement massif de capitaux japonais, d’une amélioration conséquente de son réseaux ferroviaire. Il est alors plus dense que dans la totalité de la Chine si l’on prend en compte le kilométrage total de voies ferrées, avec un total de 2’200 km de chemin de fer en 1919[36]. Cette introduction massive du chemin de fer améliore le transit des marchandises dans un pays au relief très montagneux. La seconde réforme extrêmement importante des Japonais est la mise en place d’un nouveau cadastre entre 1910 et 1918[37], d’une refonte de l’ancien système agraire complétée par une nouvelle loi agraire. Les terres héréditaires d’une partie des yangban à savoir des lignages lettrés confucéens avec un poste de fonctionnaire sont redistribuées aux journaliers, ce qui leur permet de devenir propriétaires du lopin de terre qu’ils cultivent[38]. Les officiers du cadastre consignent soigneusement dans des registres une liste des possédants ainsi que de leurs avoirs. Les différentes parcelles sont précisément délimitées[39]. Ces mêmes registres sont détruits pendant la Guerre de Corée, car à l’intérieur de ceux-ci se trouvent les noms des personnes ayant contractés des dettes et cherchent donc à se débarrasser des preuves, annulant par la même occasion ces dettes. Cette mesure achève d’abolir l’ancien monde de la royauté, même si la lignée survit pour l’instant en la personne de Sujong, le fils de Kojong. Cette réforme agraire ne comporte que peu d’avantages et profite globalement au colonisateur: les retombées positives de l’augmentation des rendements ne bénéficie pas aux strates rurales[40]. La série de redistribution des terres laisse dans la précarité une bonne partie de la population, accumulant un ressentiment envers l’autre partie accusée de l’avoir spoliée de ses terrains. Le tumulte et la confusion de la guerre civile est d’ailleurs le terrain idéal pour des règlements de compte en tous genre. Or cette facette de la guerre civile, en tant que conflit voulu par une partie de la population n’est pas diffusée à large échelle dans la mémoire collective ou dans les discours nationalistes. Une troisième et dernière mesure de l’occupant concerne un domaine plus culturel : il s’agit de l’organisation de grandes enquêtes archéologiques et historiques dans tout le territoire de la péninsule. Les archéologues et historiens de l’art japonais sont alors en quête d’artefacts mais tentent également de déterminer la physionomie de patrimoine coréen. Les grandes enquêtes archéologiques s’attachent à établir les plus belles pièces ainsi que leur valeur, dont une majeure partie est emporté au Japon[41]. Les enquêtes menées sur le terrain comportent une visée idéologique et cherchent à prouver l’origine commune des Japonais et des Coréens. Cette proximité de sang est sensée attester du bien-fondé de la colonisation japonaise comme la réunion de deux peuple issus d’une souche commune. Des travaux linguistiques vont également vouloir aboutir à une telle conclusion par un jeu de comparaison entre les deux langues[42].
L’armistice de la Première Guerre mondiale annonce un passage important de la colonisation par la fin de la mise en place de la colonie pour aboutir à la colonisation formelle. La cause de cette évolution trouve son origine dans la velléités du Japon de conserver les territoires pris à l’Allemagne dans la province du Shandong, le port de Tsingtao entre autres, durant les négociations du traité de Versailles au cours de l’année 1919. Les Japonais tentent de faire valoir leurs droits conférés par les Vingt et une demandes de l’époque Taishô, où l’Empire japonais tente d’étendre son influence en Chine[43]. Cette configuration se retrouvent en Corée, où les chefs de file du mouvement du 1e mars décide de se manifester lors des funérailles du roi Kojong, soupçonné d’avoir été empoisonné par les Japonais. Cette manifestation au départ pacifique, inspirée par les mouvances pacifistes de la Grande Guerre a pour but d’infiltrer la foule pleurant la mort de Kojong pour protester contre l’impérialisme japonais en Corée[44]. La manifestation est d’abord localisée, génère des émules à mesure que le mouvement enfle et attire des nouveaux membres. Des cas d’attaques des locaux de l’administration japonaise mène à une escalade de la violence, jusqu’à point où les manifestations sont écrasées dans le sang par des bataillons venus en renfort de la métropole. Cet état d’effervescence sociale incite le gouvernement à durcir ses méthodes de gouvernement, passant d’une administration civile à une administration militaire. Le nouvel administrateur militaire aux méthodes moins martiales, brutales, Saitô Makoto[45] succède à Hasegawa Yoshimichi. Il tente d’appliquer un mode de gouvernement s’approchant de la démocratie libérale de Taishô[46], même s’il ne faudrait pas se méprendre sur l’absence de droits politiques conférés aux sujets coréens. A l’instar du mouvement du 4 mai 1919 en Chine, le mouvement du 1e mars entérine pour la Corée une étape importante de la construction nationale de la Corée par la prise de conscience d’une nation coréenne et par la formation d’un gouvernement en exil, sous la forme d’une avant-garde organisant la résistance, sensée représenter les intérêts du peuple coréen[47]. Nous nous trouvons dans une configuration intermédiaire, une sorte d’état-nation éclaté. D’un côté, la composante de l’état moderne se trouve dans le camp de l’administration coloniale japonaise, dont les méthodes bureaucratiques permettent une gestion efficace du territoire colonisé. De l’autre côté, la composante de la nation se situe aux côtés de la population et du gouvernement en exil, qui chacun admet l’existence d’une Corée mais dont la souveraineté politique n’est pas effective.
La suite de l’histoire est bien connue de l’historiographie, car elle marque le début d’une dérive progressive à partir de la crise des importations de 1930 vers un militarisme de plus en plus féroce[48]. La période la plus dure s’ouvre suite au militarisme: la guerre civile coréenne mène à une division durable du pays en deux entités territoriales.
L’armistice de la Première Guerre mondiale annonce un passage important de la colonisation par la fin de la mise en place de la colonie pour aboutir à la colonisation formelle. La cause de cette évolution trouve son origine dans la velléités du Japon de conserver les territoires pris à l’Allemagne dans la province du Shandong, le port de Tsingtao entre autres, durant les négociations du traité de Versailles au cours de l’année 1919. Les Japonais tentent de faire valoir leurs droits conférés par les Vingt et une demandes de l’époque Taishô, où l’Empire japonais tente d’étendre son influence en Chine[43]. Cette configuration se retrouvent en Corée, où les chefs de file du mouvement du 1e mars décide de se manifester lors des funérailles du roi Kojong, soupçonné d’avoir été empoisonné par les Japonais. Cette manifestation au départ pacifique, inspirée par les mouvances pacifistes de la Grande Guerre a pour but d’infiltrer la foule pleurant la mort de Kojong pour protester contre l’impérialisme japonais en Corée[44]. La manifestation est d’abord localisée, génère des émules à mesure que le mouvement enfle et attire des nouveaux membres. Des cas d’attaques des locaux de l’administration japonaise mène à une escalade de la violence, jusqu’à point où les manifestations sont écrasées dans le sang par des bataillons venus en renfort de la métropole. Cet état d’effervescence sociale incite le gouvernement à durcir ses méthodes de gouvernement, passant d’une administration civile à une administration militaire. Le nouvel administrateur militaire aux méthodes moins martiales, brutales, Saitô Makoto[45] succède à Hasegawa Yoshimichi. Il tente d’appliquer un mode de gouvernement s’approchant de la démocratie libérale de Taishô[46], même s’il ne faudrait pas se méprendre sur l’absence de droits politiques conférés aux sujets coréens. A l’instar du mouvement du 4 mai 1919 en Chine, le mouvement du 1e mars entérine pour la Corée une étape importante de la construction nationale de la Corée par la prise de conscience d’une nation coréenne et par la formation d’un gouvernement en exil, sous la forme d’une avant-garde organisant la résistance, sensée représenter les intérêts du peuple coréen[47]. Nous nous trouvons dans une configuration intermédiaire, une sorte d’état-nation éclaté. D’un côté, la composante de l’état moderne se trouve dans le camp de l’administration coloniale japonaise, dont les méthodes bureaucratiques permettent une gestion efficace du territoire colonisé. De l’autre côté, la composante de la nation se situe aux côtés de la population et du gouvernement en exil, qui chacun admet l’existence d’une Corée mais dont la souveraineté politique n’est pas effective.
La suite de l’histoire est bien connue de l’historiographie, car elle marque le début d’une dérive progressive à partir de la crise des importations de 1930 vers un militarisme de plus en plus féroce[48]. La période la plus dure s’ouvre suite au militarisme: la guerre civile coréenne mène à une division durable du pays en deux entités territoriales.
Conclusion
Nous avons pu passer en revue, au cours de ces pages, que les antécédents de la colonisation japonaise mais aussi les étapes de la mise en place de la colonie jusqu’à la colonisation propre de la péninsule. Il est intéressant de voir à quel point la construction de l’identité nationale coréenne suit de près l’évolution politique et sociale de la Corée. Les identités nationales coréennes devrait-on dire et leurs héritiers, les nationalismes coréens, se sont construits en creux de leurs voisins immédiats. Cette construction en négatif se nourrit donc d’un antagonisme contre son voisin le Japon, mais également postérieurement entre les deux moitiés rivales du nord et du sud.
L’impact de la colonisation a donc été décisif sur la formation d’une identité commune aux deux Corées. La période coloniale a permis de catalyser un sentiment commun contre l’occupant, même si la Guerre de Corée correspond à un état d’implosion de ces mêmes forces. De nos jours, l’impact du contact avec le Japon subsiste surtout dans la mémoire collective et dans la langue coréenne moderne. La mémoire collective garde en effet le souvenir négatif mais vif de la période colonial, régulièrement réactivé par les polémiques diplomatiques entre les deux pays. De nombreux emprunts aux traductions japonaises de concepts occidentaux subsistent dans la langue moderne. L’héritage lourd laissé par la période coloniale gagne à être mieux connu, afin de mieux discerner des a priori légués par la mémoire collective et les discours idéologiques.
Bibliographie
Ouvrages de références:
Coll., Dictionnaire historique du Japon, Maison Franco-japonaise, Paris, 1963-2000, 20 vol.
Dayez-Burgeon, Pascal, Histoire de la Corée. des origines à nos jours, Tallandier, Paris, 2012.
Guex, Samuel, Au pays du matin calme: nouvelle histoire de la Corée des origines à nos jours, Flammarion, Paris, 2016.
Souyri, François, La nouvelle histoire du Japon, Perrin, Paris, 2010.
Monographies:
Kang, Man-gil, A History of Contemporary Korea, Changbi Publishers, Séoul, 1994, [Global Oriental, Folkstone, 2005].
Morris-Suzuki, Tessa, The Korean War in Asia. A hidden history, Rowman and Littlefield, Lanham, 2018.
Robinson, Michael Edson, Cultural Nationalism in Colonial Korea, 1920-1925, University of Washington Press, Seattle et Londres, 1988.
Shin, Gi-Wook, Peasant Protest and Social Change in Colonial Korea, University of Washington Press, Seattle et Londres, 1996.
Souyri, Pierre François, Moderne sans être occidental. Aux origines du Japon d’aujourd’hui, Gallimard, Paris, 2016.
Suh, Serk-Bae, Treacherous Translation. Culture, Nationalism and Colonialism in Korea and Japan from the 1910s to the 1960s, University of California Press, Londres et Berkeley, 2013.
Articles:
Delissen, Alain, «“Je suis un tigre…”. Figurations et horizons géohistoriques du monde coréen», in Ecrire l’histoire, n°4, 2009, pp. 157-166.
Lévy, Christine, « “ Femmes de réconfort ” de l’armée impériale japonaise: enjeux politiques et genre de la mémoire », in: Online Encyclopedia of Mass Violence, mars 2012, consulté le 27 mai 2019.
Babicz Lionel. « Le Japon de Meiji et la Corée », in: Ebisu, n°4, 1994. pp. 77-105.
Nanta, Arnaud, « Le débat sur l’enseignement de l’histoire du Japon », in: Matériaux pour l’histoire de notre temps, n°88, octobre-décembre 2007, pp. 13-20.
Coll., Dictionnaire historique du Japon, Maison Franco-japonaise, Paris, 1963-2000, 20 vol.
Dayez-Burgeon, Pascal, Histoire de la Corée. des origines à nos jours, Tallandier, Paris, 2012.
Guex, Samuel, Au pays du matin calme: nouvelle histoire de la Corée des origines à nos jours, Flammarion, Paris, 2016.
Souyri, François, La nouvelle histoire du Japon, Perrin, Paris, 2010.
Monographies:
Kang, Man-gil, A History of Contemporary Korea, Changbi Publishers, Séoul, 1994, [Global Oriental, Folkstone, 2005].
Morris-Suzuki, Tessa, The Korean War in Asia. A hidden history, Rowman and Littlefield, Lanham, 2018.
Robinson, Michael Edson, Cultural Nationalism in Colonial Korea, 1920-1925, University of Washington Press, Seattle et Londres, 1988.
Shin, Gi-Wook, Peasant Protest and Social Change in Colonial Korea, University of Washington Press, Seattle et Londres, 1996.
Souyri, Pierre François, Moderne sans être occidental. Aux origines du Japon d’aujourd’hui, Gallimard, Paris, 2016.
Suh, Serk-Bae, Treacherous Translation. Culture, Nationalism and Colonialism in Korea and Japan from the 1910s to the 1960s, University of California Press, Londres et Berkeley, 2013.
Articles:
Delissen, Alain, «“Je suis un tigre…”. Figurations et horizons géohistoriques du monde coréen», in Ecrire l’histoire, n°4, 2009, pp. 157-166.
Lévy, Christine, « “ Femmes de réconfort ” de l’armée impériale japonaise: enjeux politiques et genre de la mémoire », in: Online Encyclopedia of Mass Violence, mars 2012, consulté le 27 mai 2019.
Babicz Lionel. « Le Japon de Meiji et la Corée », in: Ebisu, n°4, 1994. pp. 77-105.
Nanta, Arnaud, « Le débat sur l’enseignement de l’histoire du Japon », in: Matériaux pour l’histoire de notre temps, n°88, octobre-décembre 2007, pp. 13-20.
